Municipalité
Historique

Kingsey Falls, les origines de la colonisation
La municipalité de Kingsey Falls tire son nom d'un village du comté d'Oxford en Angleterre d'où serait venu vers 1792 J. S. Kingsey, chargé de procéder à l'arpentage et à la division des terres. À son arrivée, l'arpenteur remarque l'incroyable potentiel commercial qu'offrent les réserves considérables de bois des forêts avoisinantes et la proximité des chutes de la branche sud-ouest de la rivière Nicolet. Désirant lui-même tirer avantage des atouts du territoire, l'homme se fait concéder une large bande de terre de chaque côté de la rivière qu'il n'exploite toutefois jamais.
C'est au début des années 1800 que les premiers colons, tous anglophones, s'installent sur le territoire. Un incendie survenu au printemps 1881 détruisant une vingtaine de maisons du village entraine le départ de plusieurs résidents anglais dont les biens ont été détruits par le feu. Le 11 janvier 1865, le premier maire, Alexander Gibson est élu lors de la constitution de la municipalité. On évalue alors la superficie du territoire de Kingsey Falls à 20 428 acres.
Mamidapskidzowek est le nom que les Abénaquis utilisent pour parler de la ville de Kingsey Falls. Il signifie « un cours d'eau qui coule le long des rochers ».
19e siècle : le développement de la paroisse
Vers 1870, la proportion des colons d'origine française augmente à Kingsey Falls. Dans une lettre adressée au curé de Warwick, l'évêque Mgr Laflèche esquisse le projet de l'érection d'une paroisse catholique dans le territoire compris entre Saint-Médard (Warwick), Saint-Félix, Danville et Saint-Albert.
Vers 1873, l'idée de construire une église catholique à Sainte-Élizabeth-de-Warwick plane dans la région. On croyait alors que les gens de Kingsey Falls viendraient volontiers y pratiquer. Réclamant l'érection de la paroisse de Kingsey Falls, une délégation de Kingsey-Fallois fait entendre son désaccord lors d'une assemblée devant fixer l'emplacement de la nouvelle église.
Jusqu'en 1884, les curés des paroisses avoisinantes viennent donc dire la messe à Kingsey Falls, une à deux fois par mois. Dans une lettre pastorale datant de 1877, on établit l'obligation pour les fidèles de Kingsey Falls de payer une dîme de 1 $ par année jusqu'à un maximum de 4 $ par famille afin de couvrir les frais du prêtre desservant la municipalité.
En 1884, Georges-Épiphane Caron, le prêtre qui desservait la municipalité depuis deux ans, s'installe à Kingsey Falls et devient le premier prêtre résident du village. On dénombre alors 104 familles dans le village, soit une population de plus de 700 personnes constituée de 488 catholiques et de 300 protestants.
Érection de la paroisse de Kingsey Falls
Les revendications des Kingsey Fallois portent leurs fruits en 1886 avec la construction d'une première chapelle et l'érection canonique d'abord canonique (3 mars 1886) puis civile (28 mai 1886) de la paroisse de Saint-Aimé de Kingsey Falls. Cette dernière est nommée en l'honneur de Louis-Aimé Masson, curé de Danville et premier prêtre de la nouvelle paroisse. L'année suivante, le presbytère actuel est construit au coût de 1 610,90 $. Les paroissiens s'engagent alors à payer une dîme annuelle de 2 $ par communiant.
Construction de l'église actuelle
L'évêque ayant déjà donné son autorisation, la construction de l'église est décidée lors d'une assemblée tenue en novembre 1895. Un terrain voisin du presbytère avait d'ailleurs été acquis six ans auparavant pour accueillir le nouveau lieu de culte. Pour couvrir les frais de la construction, on propose de faire un emprunt de 1 000 $, tandis que l'abbé G. E. Caron prête 2 000 $.
À la fin de l'année 1896, on procède à la bénédiction de l'église actuelle dont la construction a coûté un total de 4 990,46 $. Ce montant comprend l'achat, au coût de 76 $, d'une cloche à la paroisse Saint-Christophe d'Arthabaska.
L'église et le presbytère de Kingsey Falls de nos jours
G.E. Caron n'exerce que brièvement ses fonctions dans la nouvelle église puisqu'il meurt en 1897 à l'âge de 41 ans, laissant à la Fabrique la somme qu'il a prêtée.
En 1900, une résolution est adoptée pour l'achat d'un terrain de 1¾ acre au coût de 100 $ pour y installer le cimetière du village qui est béni le 24 juin 1901.
G. E. Caron, le premier prêtre résident de Kingsey Falls
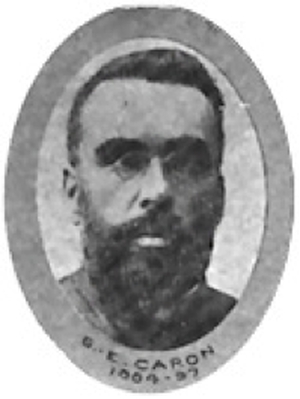

Les écoles
Le 20 avril 1850, une pétition pour l'établissement d'un district scolaire à la limite la municipalité de Kingsey Falls, près de la rivière Nicolet, est déposée par quelques contribuables du village. Cette école, anglaise évidemment, portant d'abord le numéro 14 est nommée la Winter School.
En 1866, une assemblée de tous les habitants de la Corporation demande la formation d'une commission scolaire. Kingsey Falls comptait alors 208 enfants d'âge scolaire, dont 88 enfants de 5 à 6 ans, et 120 enfants de 7 à 14 ans. Il y avait au moins quatre écoles de rang sûrement protestantes si l'on se fie à leurs noms : Winter School, Cassidy's School, Brown's School, Little Warwick School (ou Summer School). En 1872, Frédéric Laliberté devient le premier commissaire francophone au sein de la commission scolaire protestante de Kingsey Falls.
Peu après la formation de la commission scolaire, une requête demandant l'ouverture d'une école catholique est présentée. On propose alors de louer une maison pour assurer l'enseignement en attendant de bâtir une maison d'école. Les écoles de rang demeureront longtemps actives à Kingsey Falls, et ce, même si une assemblée des marguilliers propose, en 1901, que la fabrique concède l'usage d'un arpent de terrain aux syndics des écoles chrétiennes pour la construction d'une école pour les enfants catholiques du village.
À l'automne 1949, on procède à la bénédiction d'un couvent dirigé par les religieuses de Saint-Joseph qui enseignent à plus de 110 garçons et filles de la première à la dixième année. L'établissement contient quatre classes, une salle de récréation, une petite chapelle et la résidence des quatre religieuses. Ce couvent deviendra l'école Saint-Joseph reliée à l'école Saint-Georges sise à ses côtés. En 1989, une nouvelle école est construite : l'École Cascatelle.
Le frère Marie-Victorin
Pionnier de l'enseignement de la botanique au Québec et fondateur du Jardin botanique de Montréal, Conrad Kirouac, mieux connu sous le nom du frère Marie-Victorin, est le plus célèbre personnage de Kingsey Falls.
Né à Kingsey Falls le 3 avril 1885, ce célèbre frère des écoles chrétiennes perd accidentellement la vie le 15 juillet 1944 au retour d'un voyage d'herborisation à Black Lake. Le frère Marie-Victorin a consacré sa vie à l'étude et à l'enseignement de la botanique et des sciences naturelles. Il est à l'origine de la fondation de l'Institut botanique de l'Université de Montréal. Ses travaux et ses écrits ont contribué à sa réputation mondiale.
Le frère Marie-Victorin naquit à l'emplacement actuel du 405, rue Marie-Victorin

20e siècle : modernisation et division
En 1908, les habitants de Kingsey Falls élisent le premier maire francophone de la municipalité. Pierre Tardif est le quinzième maire, et il n'y aura après lui qu'un seul maire anglophone.
Quatre ans plus tard, Kingsey Falls compte 1 200 habitants. Plus de 200 terres cultivables jalonnent le territoire, et la plupart des fermes appartenant aux propriétaires anglais sont à vendre. On encourage alors les gens des alentours à venir s'installer à Kingsey Falls qui se positionne alors comme un lieu stratégique en raison de la présence de la manufacture qui achète tout le bois que les bûcherons veulent vendre.
Le village se développe : des trottoirs en bois sont construits et les routes sont améliorées. En 1916, le ministère de la Voirie accorde 3 000 $ de subventions pour le gravelage des routes du village.
1922 : Division de la municipalité
La modernisation du village ne plait toutefois pas à tout le monde! Les habitants de la campagne refusent notamment de payer pour la construction des trottoirs dans le village. Le 26 janvier 1922, la municipalité de Kingsey Falls est divisée en deux municipalités, le village et la paroisse, fusionnés de nouveau en 1997 pour former la Ville de Kingsey Falls.
La modernisation du village se poursuit
En 1937, l'éclairage électrique arrive au presbytère, à la sacristie ainsi qu'à la cave de l'église du village. Le coût de cette installation s'élève à 188 $. L'année suivante, les rues commencent à s'illuminer. Graduellement, l'électrification gagne aussi les maisons du village.
En seulement une décennie, plusieurs constructions voient le jour à Kingsey Falls, notamment la Caisse populaire qui ouvre ses portes en 1940. Deux ans plus tard, on inaugure la nouvelle salle municipale dont une partie sert de garage municipal et une autre de salle pour les concerts. Au deuxième étage se déroulent les assemblées mensuelles du conseil municipal et des associations locales. On profite aussi de l'occasion pour faire l'ouverture de la rue Caron, fraichement asphaltée.
Inauguration officielle de la salle municipale

La Dominion Paper Co.

Les industries fondatrices : les moulins à scie et à papier
En 1843, les frères J. et G. Gillman installent et opèrent un moulin à scie à Kingsey Falls. Vingt ans plus tard, Georges Rigley construit une autre scierie suivie, quelques années plus tard, d'un moulin à farine. Racheté par les frères W. et P. P. Curie, ce moulin à farine est transformé en moulin à papier en 1872. Opérant sous le nom de Dominion Paper Mills Co., la manufacture démarre ses activités en 1873 et fabrique une diversité de produits : des enveloppes de toutes sortes jusqu'au papier à écrire, en passant par les différentes qualités de papier d'emballage.
En 1864, le moulin à papier brûle à la suite d'une explosion. Seule la section de pulpe mécanique, qui venait d'ailleurs tout juste d'être aménagée, est épargnée. En 1902, une machine est achetée d'une compagnie américaine en faillite.
En 1921, le feu fait de nouveau des ravages. Heureusement, la machinerie est épargnée cette fois. La reconstruction du moulin ralentit cependant la production qu'on limite alors au papier d'emballage et au carton pour la fabrication de boîtes. La production est portée à 20 tonnes par jour.
Pendant la décennie 1930, plusieurs moulins à papier ferment leurs portes en raison de difficultés financières. Grâce à la diversité de sa gamme de produits, la Dominion Paper Co. réussit à traverser la crise et réalise même des profits!
Des années difficiles
La période de la Seconde Guerre mondiale est particulièrement prospère pour la compagnie. Malheureusement, les administrateurs n'ont pas su réinvestir ces profits dans le renouvellement de l'équipement. La compagnie est ainsi rapidement supplantée par les usines concurrentes dont la productivité est accrue grâce à des équipements plus modernes. La situation financière se détériorant, les intérêts de la compagnie sont vendus en 1951 à la compagnie Sterling Paper Co. qui réussit à opérer l'usine pendant six ans en faisant quelques changements mineurs à la machinerie. Faute de rentabilité, les propriétaires sont toutefois obligés de fermer l'usine en 1957.
La même année, grâce aux interventions du gouvernement du Québec et des autorités du village, Louis Coderre, sous-ministre de I'Industrie et du Commerce, se porte acquéreur des actifs de Sterling Paper Co. qui devient la Kingsey Paper Mill Corporation. Malgré des changements majeurs dans l'équipement et l'octroi par la caisse populaire Desjardins locale d'importantes avances financières, l'entreprise ne parvient toujours pas à devenir concurrentielle. Peu de temps après, l'usine suspend ses opérations. La caisse populaire devient alors propriétaire des immeubles et assure les frais d'entretien de l'équipement ainsi que des bâtisses pendant toute la période d'inactivité de l'entreprise. Cette fermeture secoue la population, et une rumeur voulant que Kingsey Falls soit menacé de devenir un village fantôme se répand dans la région.
Cascades : le retour de la prospérité
Espérant la reprise de l'usine, la plupart des 50 travailleurs ayant perdu leur emploi sont toutefois restés à Kingsey Falls. En 1963, la réouverture du moulin est annoncée alors que l'usine est louée par des industriels de Drummondville. Antonio, Bernard, Laurent Lemaire insufflent ainsi une seconde vie au vieux moulin. En 1964, la caisse transfère son dossier à l'Union régionale et une entente est signée avec la famille Lemaire : Papier Cascades Inc. est né.
Cinquante ans plus tard, il ne semble pas y avoir de limites à l'expansion que peut envisager le groupe Cascades qui compte aujourd'hui 12 000 employés répartis dans plus de 90 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord et en Europe. À Kingsey Falls, l'entreprise compte 13 usines et unités de services qui génèrent près de 1 500 emplois.
Rendez-vous sur le site du groupe Cascades pour découvrir l'histoire de ce leader local!
Kingsey Falls, aujourd'hui
Depuis l'avènement de Cascades, la population de Kingsey Falls n'a pas cessé d'augmenter, de même que le nombre de maisons. Alors qu'en 1979, Kingsey Falls comptait 938 habitants, soit 663 résidents au village et 275 en zone rurale, on dénombre en 2023, 1 976 habitants.
Le Parc Marie-Victorin
C'est en 1985 que le Parc Marie-Victorin, aménagé en l'honneur du frère Marie-Victorin, inaugure son tout premier jardin. Ce parc reflète la philosophie du botaniste, particulièrement sa volonté de démystifier la botanique et d'apprendre aux gens à nommer les plantes par leurs noms. D'une superficie de 4 acres à son ouverture, le Parc Marie-Victorin déploie, 30 ans plus tard, sa beauté sur 29 acres.
http://www.parcmarievictorin.com/historique
La passerelle des Bâtisseurs
Construit sur les ruines de l'ancien moulin à farine, en 2014, par Cascades à l'occasion de son 50e anniversaire, ce pont piétonnier enjambe la rivière Nicolet. Reliant le parc municipal et le parc Marie-Victorin, la passerelle est constituée à 75 % de matériaux recyclés tels que des poutres de ponts roulants, des cellules de désencrage, des garde-corps et des planches de plastique recyclé. Illuminée en soirée, cette oeuvre unique en Amérique du Nord sert de lieu de rassemblement pour toute la communauté.

